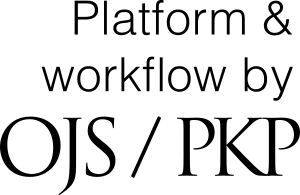Rôle du compost dans l’atténuation de l’effet du stress hydrique sur la pomme de terre
DOI :
https://doi.org/10.5281/zenodo.15068589Mots-clés :
compost, pomme de terre, stress hydrique, la croissanceRésumé
Le rôle du compost dans l’atténuation de l’effet du stress hydrique sur la croissance de pomme de terre a été évalué moyennant certains paramètres qualitatifs, de production et biochimiques. L’essai a été mené en présence ou en absence de compost (30 tonnes/hectare) sous trois régimes hydriques différents (100, 75 et 50% ETc). Les résultats ont montré que le stress hydrique affectait tous les paramètres étudiés. Cependant, la présence du compost a amélioré certains paramètres qualitatifs tels que le calibre des tubercules (plus de 82 % des tubercules sont de gros calibre) et leur poids moyen. La déformation des tubercules n’a été observée que chez les plantes cultivées en cas d’absence de compost, avec des pourcentages respectifs allant de 13,3 % à 20,0 % pour les traitements 75 % à 50 % ETc. Le rendement a été moins affecté par le stress hydrique, surtout avec l’apport du compost. Dans tous les cas, une désintégration membranaire a été notée mais qui est moins accentuée en présence du compost. Pour surmonter le stress hydrique, la pomme de terre a accumulé des sucres solubles et de la proline. Ces accumulations ont été plus importantes en présence du compost.
Mots clés: Compost, pomme de terre, stress hydrique, croissance
Téléchargements
INTRODUCTION
Compte tenu de l’accroissement de la population humaine, environ 8,2 milliards en 2024, on prévoit une augmentation mondiale de 60% sur les produits agricoles d’ici 2050 (FAO, 2010). Ce défi est plus important en Tunisie, où la production agricole est fortement impactée par les changements climatiques, tels que la rareté des précipitations et les hautes températures. Ces derniers rendent la production agricole faible et irrégulière.
Parmi les zones les plus vulnérables à ces changements climatiques, la zone de Sidi Bouzid, considérée comme étant un important pôle maraîcher, procurant plus de 18% de la production nationale légumière. La production maraîchère de cette région consomme d’énormes quantités d’eau et d’intrants chimiques importés, ce qui entraîne des coûts de production élevés et des effets néfastes non seulement sur l’environnement (contamination de la nappe phréatique et le sol) mais aussi sur la qualité nutritive des produits maraîchers.
Et par conséquent, l’irrigation rationnelle et l’application d’une bonne pratique agricole comme l'apport du compost sont devenues indispensables. Pour faire face à la rareté des ressources hydriques, une irrigation déficitaire raisonnée semble être une solution fiable pour fournir des produits maraîchers de qualité et assurer des gains acceptables pour l’agriculteur. Ainsi, Il a été rapporté que le compost augmente le pouvoir de rétention d’eau du sol en augmentant sa réserve utile (Lai, 1974) et réduit l’évaporation du sol (Movahedi-Naeini et Cook, 2000). Son application pourrait non seulement atténuer l’effet du stress hydrique sur la plante mais aussi améliorer son adaptation.
En Tunisie, la pomme de terre occupe une place prépondérante dans l’économie nationale, tant sur le plan de superficie que sur le plan de la production. Cette culture exigeante en eau et en fertilisants a été choisie pour faire l’objet du présent travail.
L’objectif de ce travail est d’étudier le rôle du compost dans l’amélioration de l’adaptation de la pomme de terre cultivée sous stress hydrique.
MÉTHODOLOGIE
L’essai a été installé dans la parcelle expérimentale du Centre Régional des Recherches Agricoles Sidi Bouzid, situé au centre ouest de la Tunisie. Le sol de la parcelle est de type sableux. Le climat est typiquement semi aride, avec une température minimale de 11,4°C et maximale de 26,4°C. La pluviométrie annuelle est de 241mm/an. La salinité de l’eau du sondage utilisée pour l’irrigation est de l’ordre de 2,7 g/L. La parcelle a été divisée en deux parcelles élémentaires, l'une avec 30 tonnes/ha ajouté une semaine avant la plantation et l'autre sans compost. Chaque parcelle élémentaire est divisée en trois autres parcelles contenant chacune 10 lignes. Les traitements expérimentaux utilisés sont:
• T1: irrigation avec 100% ETc + sans compost (ETc: Evapotranspiration de la culture)
• T2: irrigation avec 75% ETc + sans compost
• T3: irrigation avec 50% ETc + sans compost
• T4: irrigation avec 100% ETc + avec compost
• T5: irrigation avec 75% ETc + avec compost
• T6: irrigation avec 50% ETc + avec compost
Les besoins en eau de la culture, équivaux à l’’évapotranspiration de la culture (ETc), ont été calculés d’après la formule adaptée par Allen et al, (1998):
ETc = kc × ET0
Avec ETc: l’évapotranspiration de la culture; kc: coefficient cultural et ET0: évapotranspiration de référence.
Les tubercules de la pomme de terre utilisés sont de la variété Spunta. Certaines mesures ont été effectuées au niveau de chaque traitement:
• A la récolte, le pourcentage de verdissement et de déformation des tubercules, leur calibre (Petit calibre (Ø<35mm), moyen calibre (35mm <Ø<55mm), grand calibre (Ø>55mm)), leur nombre moyen, leur poids moyen par plante, leur poids frais et sec et le rendement par hectare ont été déterminés. L’arrachage a porté sur 9 plantes par traitement.
• Dosage du MDA: Selon Alia et al. (1995), l’homogénéisation de 0,25g du tubercule avec 2,5 ml de tampon phosphate 67 mM et de 0,05 g de PVP est suivie d’une centrifugation à 14000 tours pendant 10 min à 4°C. 750 µL du surnageant a été ajouté à 3 ml de TBA 0,5% préparé dans l’acide trichloroacétique (TCA) 20%. Le mélange est incubé à 90°C pendant 10 min. L’absorbance du surnageant, obtenu après centrifugation à 2000 tours pendant 15 min, est lue à 532 nm et 600 nm. La concentration de MDA est calculée en utilisant son coefficient d’extinction 155 mM-1cm-1.
• Dosage de la Proline: Selon Troll et Lindsley, (1955) améliorée par Lahrer et Magne cité par Leport, (1992), 100 mg de tubercule a été extraite dans 2 ml d’éthanol à 40% puis chauffé au bain marie à 85°C pendant 1 heure. Puis, 1 ml de l’extrait a été mélangé avec 1ml du réactif de ninhydrine dans 1 ml d’acide acétique. Après 30 min au bain-marie bouillant, la réaction est arrêtée par refroidissement dans la glace. Ensuite, 5 ml de toluène sont ajoutés et l’ensemble a été mélangé au vortex pendant 2 min avant incubation à la température ambiante puis lecture de l’absorbance à 528 nm.
• Dosage des Sucres solubles: Selon Dubois (1956), 100 mg de tubercule ont été extraites dans 3 ml d’éthanol à 80%. Après incubation à une température ambiante pendant 48 h à l’obscurité, l’extrait a été filtré puis le filtrat a été dissous dans 20 ml d’eau distillée. On ajoute à 1 ml du filtrat, 1 ml de phénol à 5% et 5 ml d’acide sulfurique concentré. Après 15 min au bain-marie bouillant 30°C, le mélange a été refroidi à l’obscurité pendant 20 min. Puis, la densité optique a été mesurée à 49 nm.
Toutes les données ont été rapportées sous forme de moyennes de trois répétitions puis analysées à l'aide du programme SPSS 26. La comparaison des moyennes a été effectuée par le test Duncan et l’analyse de la variance (ANOVA).
RÉSULTATS ET DISCUSSION
Sans application du compost, le pourcentage des gros tubercules a dépassé 73% pour les traitements (50 et 75 % ETc). Cependant, Celui de petit calibre n’a pas dépassé 10% pour le traitement 50% ETc. L’application du compost a augmenté le nombre des gros tubercules oscillant entre 80 et 100% pour les traitements respectifs 50 et 75%ETc. Les tubercules de moyen calibre n’ont été observés (20%) que chez le traitement 50% ETc (Tableau 1).
En présence du compost, aucune déformation des tubercules n’a été observée. Cependant, en son absence, quelques déformations ont été notées chez 13 à 20 % des tubercules des traitements respectifs 50 et 75 % ETc. Le verdissement des tubercules a été observé dans tous les cas (13.3 % en absence du compost et jusqu’à 20 % en sa présence) (Tableau 1).
Le nombre moyen des tubercules a été réduit de 10% et de 20% comparé au témoin, chez les traitements respectifs 50 et 75% ETc et en absence du compost. Cependant, l’ajout de ce dernier n’a pas eu d’effet significatif sur ce paramètre. La variation du nombre de tubercules par plante en conditions limitantes en eau pourrait être attribuée au type de sol et à la température (Walworthet Carling, 2002).Le stress hydrique cause habituellement la sénescence prématurée des feuilles raccourcissant par la suite la saison de croissance, ayant pour résultat des rendements inférieurs de tubercules (Jeffries et MacKerron, 1993) (Tableau 2).
Quant au poids moyen des tubercules, il a été réduit de 26 et 34 % chez les traitements respectifs 75 et 50% ETc, seulement en absence du compost. Le poids frais et sec des tubercules a été réduit dans tous les cas mais moins accentuée en présence du compost. Jefferies et MacKerron (1986) ont révélé qu’un stress hydrique trop précoce, à l’initiation tuberculaire, réduit la tubérisation et limite le calibre moyen, d’où la diminution du taux moyen de matière sèche. De plus, Makaraviciute (2003) a rapporté que le compost contribue à l’augmentation de la teneur en matière sèche du tubercule. Le rendement final a été réduit dans tous les cas mais cette réduction a été moins importante avec l’apport du compost. Le stress hydrique diminue à la fois la quantité et la qualité des tubercules (Rykaczewska, 2017) (Tableau 2).
Sans apport du compost, la teneur en MDA chez les traitements respectifs (75 et 50% ETc) était 1,50 et 2,45 fois plus élevée que le témoin. Cependant, l’ajout du compost a réduit l’accumulation en MDA de 1,43 et 2,08 fois plus élevée que le témoin chez les mêmes traitements. Sous stress hydrique, l’équilibre de la production et l’élimination des dérivés réactifs d’oxygène dans les plantes est perturbée. Cela conduit à l’accumulation substantielle d’oxygène actif espèces et l’aggravation de la peroxydation lipidique (Li et al., 2017) (Tableau 3).Dans tous les cas, la teneur en proline a augmenté de 2,0 et 2,8 fois par rapport au témoin chez les traitements respectifs (75 et 50% ETc). La production de la proline par les tissus des plantes sous les conditions de déficit hydrique est une réponse adaptative (Sarani et al., 2014), puisque ce soluté compatible peut ajuster le potentiel osmotique dans le cytoplasme (Caballero et al., 2005) et être utilisé comme un marqueur physiologique en relation avec le stress osmotique (Tableau 3).
Ainsi, une augmentation significative de la teneur en sucres a été notée dans tous les cas, particulièrement pour le traitement hydrique (50%) avec une teneur 3 à 4 fois plus élevé que le témoin. Les sucres solubles peuvent fonctionner comme un osmo-protecteur typique, stabilisant les membranes cellulaires et maintenant la pression de turgescence (Izanloo et al., 2008) (Tableau 3).
CONCLUSION
L’objectif de ce travail est d’étudier l’effet du compost sur les paramètres qualitatifs, de production et biochimiques de la pomme de terre cultivée sous stress hydrique.
Les résultats ont montré que certains paramètres comme le calibre des tubercules, leur poids moyen et le rendement total ont été améliorés en présence du compost. Dans tous les cas, des perturbations membranaires marquées par une accumulation du MDA ont été notées mais moins accentuées en présence du compost. Pour maintenir sa croissance et faire face au stress hydrique, les plantes ont accumulé de la proline et des sucres solubles. Ces résultats prouvent le rôle promoteur joué par le compost dans l’atténuation de l’effet du stress hydrique. Cependant, des essais supplémentaires sont nécessaires afin de déterminer la meilleure irrigation déficitaire donnant un rendement satisfaisant et des tubercules de bonne qualité.
RÉFÉRENCES
Allen R.G., Perreira L.S., Raes D., Smith M. (1998). Crop Evapotranspiration: Guidelines for Computing Crop Water Requirements. Irrigation and Drainage Paper, N° 56, FAO, Rome, 300.
Caballero Y., Morel S., Habets F., Noilhan J., Le Moigne R., Lehenaff A., Boone A. (2005). Hydrological sensitivity of the Adour Garonne river basin to climate change. Water Ressources Research, 43, W07448, 19 p.
Izanloo A., Condon A., Langridge P., Tester M., Schnurbusch T. (2008). Different mechanisms of adaptation to cyclic water stress in two South Australian bread wheat cultivars . Journal of Experimental Botany, 59: 3327–3346.
Li C., Miao X., Li F., Wang S., Liu Q., Wang Y., Sun J. (2017). Oxidative stress related mechanisms and antioxidant therapy in diabetic retinopathy. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 9702820.
Rykaczewska K. (2017). Impact of heat and drought stresses on size and quality of the potato yield. Plant, Soil and Environment, 63:40–46.
Sarani S., Heidari M. (2014). Growth, biochemical components and ion content of chamomile (Matricaria chamomilla L.) under salinity stress and iron deficiency. J. Saudi Soc. Agric. Sci., 11:37–42.

Publié-e
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence

Revue Marocaine des Sciences Agronomiques et Vétérinaires est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.
Fondé(e) sur une œuvre à www.agrimaroc.org.
Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à www.agrimaroc.org.