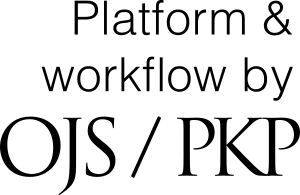Inventaire des champignons associés aux symptômes de la gommose de l’anacardier au Burkina Faso
DOI :
https://doi.org/10.5281/zenodo.16568764Mots-clés :
Anacardium occidentale, champignons, incidence, sévérité, province, Burkina FasoRésumé
Cette étude vise à évaluer l’incidence et la sévérité de la gommose d’anacardier, à décrire les symptômes et à inventorier les agents fongiques associés. Elle a été conduite dans sept (07) provinces dont le Houet, le Kénédougou, la Léraba, la Comoé, le Poni, le Noumbiel et la Sissili, dans des vergers d’anacardier qui hébergent des arbres «candidats élites». Les principaux symptômes observés incluent des chancres noirs avec exsudation de gomme, suivis du dessèchement des rameaux, de la chute des feuilles et du dépérissement total de l’arbre. Les analyses ont montré des différences significatives de l’incidence variant de 63,8 % à 100 %, et de la sévérité allant de 19,9 % à 46,1 %, selon les localités. Huit espèces fongiques ont identifié dont Lasiodiplodia spp (51 %), Pestalotia spp et Fusarium spp (13 %), Aspergillus niger (10 %), Colletotrichum gloeosporioides (6 %), Penicillium sp (5 %), Curvularia lunata (2 %) et Botrytis cinerea (2 %). Ces résultats soulignent l’importance sanitaire de la maladie dans les vergers étudiés et la diversité fongique associée. Une caractérisation moléculaire associée au test de pathogénicité permettraient de déterminer l’agent ou les agents fongique (s) associés pour un contrôle efficient de la maladie.
Mots-clés: Anacardium occidentale, champignons, incidence, sévérité, province, Burkina Faso
Téléchargements
INTRODUCTION
La production d’anacardier (Anacardium occidentale L.) est d’une importance capitale sur le plan économique en Afrique de l’Ouest, surtout au Burkina Faso. Cependant, cette culture est confrontée à des contraintes d’ordre pathologique, parmi lesquels la gommose qui de nos jours prend de l’ampleur. La maladie se manifeste visiblement par l’exsudation de gomme sur les troncs et les branches, allant jusqu’au dessèchement partiel ou total de la plante, entraînant ainsi des baisses de rendements.
Au Brésil, l’espèce Lasiodiplodia pseudotheobromae a été associée à la gommose de l’anacardier (Coutinho et al., 2017). Dans le même pays, Netto et al. (2017) ont trouvé que Lasiodiplodia theobromae est l’espèce la plus répandue dans la gommose de l’anacardier. En Inde, Gnanesh et al. (2022) ont isolé cinq (05) agents pathogènes fongiques qui sont responsables de la gommose. Il s’agit de Botryosphaeria dothidea, Diplodia olivarum, Diplodia seriata, Neofusicoccum australe et Neofusicoccum parvum. En Indonésie, l’espèce Ceratocystis fimbriata a été signalée sur la gommose de l’Acacia decurrens (Rahayu et al., 2021).
Par ailleurs, en Ethiopie, la gommose sur le mandarinier est provoquée par le champignon Phytophthora spp (Thakre et al., 2017). En Côte d’Ivoire, un complexe d’association de champignons de Lasiodiplodia theobromae et Pestalotia heterocornis a été isolé sur des chancres noirs des rameaux (Nakpalo et al., 2017). Au Ghana, c’est Colletotrichum gloeosporioides et Lasiodiplodia theobromae qui ont été identifiés à la gommose des rameaux et des tiges. L. theobromae, est également associé aux brûlures, au dépérissement des rameaux et de l’inflorescence (Muntala et al., 2021). Au Togo, les travaux de Banito et al. (2022) ont trouvé l’espèce Lasiodiplodia theobromae associée à la gommose de l’anacardier.
Au Burkina Faso les travaux de Dianda et al. (2020) ont montré que l’espèce L. theobromae est associée au dessèchement du manguier.
Cependant, au Burkina Faso, il existe peu d’information sur ladite maladie. C’est ainsi que s’inscrit la présente étude qui a pour objectifs spécifiques:
1) d’évaluer l’incidence et la sévérité de la gommose, 2) de décrire les différents symptômes de la maladie, et 3) d’identifier les champignons associés aux organes malades.
Cette étude nous permettra de disposer de plus de connaissances ou d’informations sur la maladie, ce qui favorisera la mise en œuvre de stratégies de gestion et de lutte plus efficaces.
MATÉRIEL ET MÉTHODES
Sites d’étude
La prospection a été faite en janvier 2024 dans sept (07) provinces du Burkina Faso, à savoir le Houet et le Kénédougou dans la région des Hauts-Bassins, la Léraba et la Comoé dans la région des Cascades, le Poni et le Noumbiel dans la région du Sud-Ouest, et la Sissili dans la région du Centre-Ouest (Figure 1). Ces zones sont par excellence productrices de noix de cajou sur le plan national. Le choix de ces sites de collecte d’échantillons repose sur le fait qu’ils hébergent aussi les arbres «candidats élites», sélectionnés par le programme d’amélioration variétale de l’INERA sur la base de leurs performances agronomiques et de leur bon état sanitaire à l’origine. Ces sites hébergent aujourd’hui des sujets plus ou moins sévèrement attaqués.
Caractéristiques de la zone d’étude
La région des Hauts-Bassins qui abrite est limitée au nord par la région de la Boucle du Mouhoun, au sud par la région des Cascades, à l’est par la région du Sud-Ouest et à l’ouest par la République du Mali. Il couvre une superficie totale de 25 479 km2, soit 9,4% du territoire national. La pluviométrie annuelle varie de 800 à 1200 mm. La région des Cascades se trouve à l’extrême ouest du territoire. D’une superficie de 18 917 km2, elle est limitée au nord par la région des Hauts-Bassins, au sud par la République de Côte d’Ivoire, à l’est par la région du Sud-Ouest et à l’ouest par la République du Mali. La pluviométrie annuelle dans la région varie de 1000 à 1200 mm. La région du Sud-Ouest occupe 16 533 km², bordée à l’est par le Ghana et la région du Centre-Ouest, à l’ouest par les Cascades et les Hauts-Bassins, au nord par les Hauts-Bassins, la Boucle du Mouhoun et le Centre-Ouest et au sud par la Côte-Ivoire. Dans le Sud-Ouest les précipitations annuelles se situent entre 900 et 1200 mm. La région du Centre-Ouest qui couvre une superficie de 21 891 km² du territoire, limitée au sud par le Ghana, au nord par la région du Nord, à l’est par les régions du Centre et du Centre-Sud, à l’ouest par la région de la Côte d’Ivoire et à l’ouest par la région de la Côte d’Ivoire. La région reçoit une pluviométrie comprise entre 600 mm et 1200 mm par an (RGPH, 2009).
Évaluation de l’incidence et de la sévérité de la gommose d’anacardier des zones d’étude
L’incidence et la sévérité de la maladie ont été déterminées sur une échelle de 50 arbres dont l’arbre «candidat-élite» dans chaque verger. Le choix des 50 arbres a été fait de manière aléatoire, avec une distance de 30 m d’un arbre à l’autre. L’incidence a été calculée selon la formule suivante: I(%)=n/N x 100 (avec n= nombre de pieds malades, et N= nombre de pieds de l’échantillon) (Cooke, 2006). Quant à l’indice de sévérité (IS), elle a été estimée par l’équation suivante: IS=∑(xini)/n; où xi représente la note de l’échelle de notation avec i allant de 0 à 4; ni représente le nombre de plantes malades de degré i sur l’échelle, et n est le nombre total de plantes malades évaluées. L’échelle de notation selon Cardoso et al. (1998) est la suivante:
0: aucun symptôme;
1: petit et peu de chancres sur le tronc et branches, petite fissure sans exsudation de gomme;
2: larges chancres fissurés sur les troncs et les branches, occupant les 1/3 du diamètre, avec peu ou pas d’exsudation de gomme;
3: chancres fissurés sur les troncs et les branches, supérieurs au 1/3 du diamètre, avec exsudation abondante de gomme;
4: chancres complètement fissurés couvrant le tronc ou les branches, le feuillage jaunit, le dépérissement et exsudation de la gomme.
Collecte d’échantillons
Des échantillons de racines, des rameaux, de feuilles et d’écorce ont été prélevés sur les plantes infectées et asymptomatiques dans les sept (07) provinces de l’étude. Les prélèvements ont été faits au moyen d’une pioche, de couteaux, d’un sécateur. D’un arbre à l’autre, les outils de prélèvement ont été désinfectés avec de l’alcool (70 %) pour éviter la contamination des arbres. Les coordonnées de chaque verger ont été prises à l’aide d’un GPS. Le choix des arbres dans les différents vergers a été fait suivant les diagonales, et le prélèvement des différents organes suivants les quatre points cardinaux (Masood et al., 2010) A chaque échantillon, était attribuée une étiquette indiquant le numéro, le nom du site, la date de prélèvement, les coordonnées géographiques. Les échantillons ont été mis dans des enveloppes, plastifiés et transportés (dans une glacière) au laboratoire du Centre Régional d’Excellence en Fruits et Légume (CRE-FL), puis gardés à une température de 4 °C. Des fiches d’observation ont été utilisées pour collecter les informations relatives à chaque échantillon.
Isolement des agents fongiques
Des morceaux des différents organes collectés ont été désinfectés respectivement dans de l’alcool 70%, l’eau de javel 1% puis dans l’eau distillé stérile. Ils ont été placés dans des boites de Pétri contenant des papiers buvards précédemment stérilisés et humidifiés à l’eau distillée stérile. Quatre (04) type de fragments ont été placés dans chaque boite. Les échantillons ont été incubés à 28°C sous une alternance de 12 heures à la lumière UV et 12 heures à l’obscurité pendant 7 jours. A l’aide de la clé d’identification de Mathur et Kongsdal (2003) et des références bibliographiques, les conidies et les spores observées sur les différents organes à la loupe binoculaire et au microscope ont été identifiés. Ces caractéristiques morphologiques ont été utilisées pour inventorier les différentes espèces de champignon observées.
Analyses des données
Le logiciel Excel a été utilisé pour la saisie des données et la réalisation des graphiques. Le logiciel R (version 4.3.3) a servi au calcul des taux moyens des variables d’incidence et de sévérité de la maladie, ainsi qu’au calcul des pourcentages des différentes espèces de champignons isolées.
RÉSULTATS
Symptômes de la maladie
De multiples symptômes ont été observés sur les 77 (soixante-dix-sept) arbres «candidats élites» et les autres arbres de chaque verger. Les symptômes observés sont notamment les chancres noirs ouverts ou fermés (Figure 2A-C) et une exsudation de gomme brunâtre de quantité variable (Figure 2D-F).
D’autres symptômes ont été observés sur les arbres étudiés. Il s’agit du dessèchement partiel (Figure 3A) et total (Figure 3B, C) des pieds d’anacardiers, jaunissement foliaire (Figure 3D), de rouille noire des noix (Figure 3E), de rejet d’un anacardier après application de la méthode physique par le producteur (Figure 3F).
Incidence de la maladie dans les provinces d’étude
Les vergers concernés dans l’étude ont une fourchette d’âge comprise entre 9 et 23 ans. Les résultats de l’analyse statistique ont révélé une différence très hautement significative entre les provinces pour la variable ‘incidence’, avec une p-value de 0,000977, inférieure au seuil de 0,05. Les valeurs minimales et maximales sont respectivement de 22 % et 100 %. Les valeurs moyennes de l’incidence sont comprises entre 63,8 et 100 %. Le Kénédougou a enregistré la faible valeur moyenne d’incidence 63,8 %, observée dans les anacardiers âgés de 9 à 19 ans, et le maximum 100 % dans les provinces du Houet, le Noumbiel, le Poni où les arbres ont un âge compris entre 7 et 20 ans. Le tableau 1 montre les valeurs de l’incidence de la gommose selon les provinces concernées.
Sévérité de la maladie dans les provinces d’étude
Les résultats de l’analyse ont montré une différence très hautement significative de la variable ‘sévérité’ entre les provinces, avec une p-value de 0,000143, inférieure à 0,05. Les valeurs de sévérité sont comprises entre 6 % et 62,5 %. La valeur moyenne minimale (19,9 %) a été enregistrée dans le Kénédougou, tandis que la valeur moyenne maximale (46,1 %) a été observée dans la Sissili.
Le tableau 2 montre les valeurs de sévérité de la gommose d’anacardier selon les provinces concernées.
Relation existante entre l’incidence et la sévérité
Nous avons voulu voir la relation entre l’incidence et la sévérité, dont la corrélation. Les résultats d’analyses avec le test de corrélation de Spearman, ont montré une p-value = 1,095 x 10-13, et le coefficient de corrélation de Spearman (ρ = 0,857). Cela signifie qu’il y a une forte corrélation positive entre l’incidence et la sévérité. Cela montrerait que plus l’incidence est élevée plus la sévérité augmente.
Inventaire des champignons sur des organes malades collectés
L’inventaire a révélé la présence de 8 (huit) champignons pathogènes (Figure 4). Il ressort des analyses, que l’espèce Lasiodiplodia spp (51 %) est majoritaire, suivie par Pestalotia spp et Fusarium spp (13 %), ainsi que Aspergillus niger (10 %). D’autres espèces ont été rencontrées de manière occasionnelle, dont Colletotrichum gloeosporioides (6 %), Penicillium sp (5 %), Curvularia lunata (2 %) et Botrytis cinerea (2 %). La figure 4 ci-dessous montre les pourcentages des différents champignons rencontrés.
Diversité des champignons identifiés selon les provinces étudiées
Une variabilité de la diversité fongique a été observée selon les provinces de la zone d’étude. Les résultats de l’analyse statistique ont révélé une différence significative entre les provinces en termes de diversité fongique (p = 0,0251, inférieure au seuil de 0,05). Les genres Lasiodiplodia, Pestalotia, Aspergillus et Fusarium par leur fréquence élevée, sont les plus prédominants. La répartition des genres fongiques montre que l’ensemble des huit (8) genres identifiés est présent dans la province du Kénédougou, contre sept (7) dans la province de la Léraba, six (6) dans les provinces de la Comoé et du Noumbiel, cinq (5) dans celles du Houet et du Poni, et quatre (4) dans la province de la Sissili. Les fréquences calculées pour chaque espèce de champignon en fonction de la région d’échantillonnage sont consignées dans le tableau 5 ci-dessous.
Champignons isolés selon les organes collectés
Une gamme variée de champignons a été isolée des organes malades suivants des symptômes observés. Il ressort des résultats de l’inventaire que l’espèce Lasiodiplodia spp, Fusarium spp, et Aspergillus niger sont présentes dans l’ensemble des organes malades collectés. En fonction des organes, Lasiodiplodia spp, est majoritairement représentée sur les rameaux (36,1 %), tandis que Pestalotia spp prédomine sur les feuilles (16,8 %). La figure 5 montre les fréquences des champignons suivant l’organe malade incubé (feuille, rameau, écorce, racines).
DISCUSSION
Les différents symptômes observés au cours de la prospection incluent notamment des chancres noirs localisés ou répandus sur l’arbre, avec ou sans exsudation de gomme sur le tronc et les branches des anacardiers. Ces symptômes pourraient être ceux caractéristiques de la gommose. En effet, selon Monteiro et al. (2020) du Brésil, la gommose des anacardiers se manifeste généralement par des chancres noirs répandus sur le tronc, les rameaux et les branches, qui se fissurent et laissent couler de la gomme. En plus, des symptômes cités ci-dessus, la chute des feuilles a été observée dans les différents vergers. Ce qui serait un autre symptôme lié à la gommose qui affecte le système d’alimentation de la plante. Ces résultats sont similaires à ceux de Wonni et al. (2017) au Burkina Faso, qui ont rapporté que les symptômes les plus visibles de la gommose sur l’anacardier sont l’exsudation jaune et la chute des feuilles, qui se manifestent aussi bien chez les jeunes plantes que chez les plantes adultes.
Lors de la prospection, des symptômes de chancres noirs sans exsudation ont été observés sur certains arbres. Cela suggérerait que les chancres noirs sont les premiers signes présageant la gommose. Au fil du temps, les chancres se seraient craquelés et favoriseraient l’exsudation. Turcotte et al. (2017) ont signalé que les chancres noirs sur les branches charpentières et le tronc du cerisier sont généralement associés à la présence de la gommose. Nous avons constaté que les valeurs moyennes de l’incidence sont comprises entre 63,8 % et 100 % et la sévérité entre 19,9 % et 46,1 % qui témoignent de l’ampleur de la maladie dans la zone d’étude. Ainsi des blessures ou petites fissures et des outils d’entretien constitueraient des portes d’entrée pour le pathogène responsable de la maladie. En effet, selon Moreira-Morrillo et al. (2021), la dissémination des Botryosphaeriaceae, incluant Lasiodiplodia theobromae, peut se faire par contamination au moment du greffage et de l’élagage avec des outils non stérilisés. Les études de Rahman (2023) au Bangladesh ont trouvé une incidence de 42,9 % et une sévérité de 54,4% les plus élevées de la gommose chez le flamboyant en Inde (Samanea saman) observées à Mongola Sadar Thana (district de Bagerhat). Par contre, elles étaient faibles de 12,6 % et de 18,3 % respectivement pour l’incidence et la sévérité à Satkhira Sadar Thana (district de Satkhira), selon les mêmes auteurs. Par ailleurs, une incidence de 20 à 30 % a été signalée par les auteurs Savitha et Garampalli (2022) sur la gommose et la brûlure des feuilles de Momordica charantia causées par Lasiodiplodia theobromae. En Afrique de l’Ouest, notamment au Ghana, l’incidence de la gommose d’anacardier était comprise entre 6,9 % et 14%, selon Muntala et al. (2021).
Dans la littérature, les champignons sont les plus cités comme agents pathogènes associés à la gommose. La présence des genres Pestalotia, Lasiodiplodia, Botrytis, Aspergillus, et Fusarium, montrerait l’existence d’une source d’infection fongique des anacardiers atteints de la gommose. Ces résultats sont en accord avec ceux de Wonni et al. (2017) qui ont inventorié quatre (04) espèces de même genre que ceux de cette étude et d’autres par ailleurs. Selon certains il y a également les espèces Fusarium, Aspergillus qui constituent une menace d’importance économique à l’anacardier. En effet, selon les auteurs Patsa et al. (2023), l’espèce Fusarium falciforme est une menace importante pour les anacardiers, ainsi que les espèces d’Arpergillus associées aux noix de cajou (Adetunji et al., 2019; Musangi et al., 2024). En outre, la présence du genre Lasiodiplodia. [synonym: Botryodiplodia theobromae (Pat) Griffon et Moube] expliquerait la gommose sur les anacardiers échantillonnés. Ces résultats sont en accord avec ceux de Khatoon et al. (2017) en Inde et Nakpalo et al. (2017) en Côte Ivoire, sur l’anacardier qui ont montré que l’espèce Lasiodiplodia theobromae est responsable de la gommose. Par ailleurs, les études de El-Ganainy et al. (2022) et de Rahayu et al. (2021) associent l’espèce Lasiodiplodia theobromae à la gommose des arbres fruitiers et ceux forestiers. Au Burkina Faso, la même espèce a été signalée par Dianda et al. (2025) comme agent responsable de la gommose et du dessèchement de l’anacardier. Le champignon Lasiodiplodia spp, a été isolé sur tous les organes malades collectés. Cela pourrait s’expliquer par le fait que le champignon a une croissance très rapide, et parvient à se propager sur toutes les parties de la plante. Ces résultats sont similaires à ceux de Dianda et al. (2020), qui ont trouvé des isolats de L. theobromae sur des feuilles, des brindilles et des racines collectées sur des manguiers attaqués par le dessèchement.
L’infection des racines par certains champignons montrent qu’il serait d’origine tellurique. C’est le cas de Lasiodiplodia qui se retrouve dans les racines, et sur les autres parties des plantes. Et l’espèce L. theobromae survit dans les sols des plantations dont l’infection primaire se produit dans le sol et celle secondaire par des conidies dues à la pluie ou au vent (Salvatore et al., 2020).
La variabilité de la diversité fongique observée par province pourrait s’expliquer par des paramètres agroécologiques tels que l’humidité, les températures, les pratiques culturales, qui favoriseraient la propagation et le développement des genres fongiques identifiés. Les hauteurs de précipitations annuelles dans ces différentes provinces sont généralement importantes, variant de 600 mm à 1200mm. De telles pluies pourraient favoriser la propagation des germes des agents pathogènes qui sont associés à la gommose par les eaux de ruissellement, contribuant ainsi au développement de la maladie.
En effet, des études antérieures ont mis en évidence l’effet de différents facteurs environnementaux sur la dispersion des spores pathogènes dans les champs agricoles. Il s’agit de l’atmosphère, les caractéristiques géographiques (Brodsky et al., 2023; Kim et al., 2019) et les eaux de pluies (Wang et al., 2021). Par ailleurs, Alves et al. (2020) ont trouvé que les facteurs tels que la température et l’altitude influencent la gravité de la gommose chez l’anacardier.
La présence des quatre (4) genres notamment Lasiodiplodia, Pestalotia, Aspergillus et Fusarium dans les sept (7) provinces d’étude pourrait s’expliquer par le fait qu’ils ont un large spectre d’hôtes et s’adaptent aux conditions climatiques variées. Par ailleurs, la répartition inégale des champignons dans les différentes provinces étudiées pourrait s’expliquer par les pratiques agricoles spécifiques à ces provinces. Des facteurs tels que les antécédents culturaux, l’intensification ou les mauvaises pratiques phytosanitaires peuvent favoriser la multiplication de certains pathogènes. Ces résultats sont en accord avec les études de Brahima et al. (2023), qui ont montré que les pratiques agricoles ont un impact considérable sur la richesse et la diversité des spores fongiques du sol.
Ces résultats confirment la nécessité de prendre en compte les paramètres écologiques et les pratiques agricoles de la zone d’étude dans la mise en place de stratégies de gestion intégrée des maladies, surtout celle de la gommose. Également, une surveillance phytosanitaire adaptée à chaque zone agroécologique serait indispensable.
CONCLUSION
La présente étude a permis d’évaluer l’incidence et la sévérité de la gommose de l’anacardier au Burkina Faso, plus précisément dans sept (07) provinces dont le Houet, le Kénédougou, la Léraba, la Comoé, le Poni, le Noumbiel et la Sissili. Il en ressort que les symptômes de la gommose de l’anacardier sont des chancres noirs répandus sur le tronc et les branches, l’exsudation anormale de gomme au niveau des chancres, le dessèchement des rameaux, la chute des feuilles, le dépérissement et la mort totale de l’arbre.
Il ressort des analyses, des différences très hautement significatives en termes d’incidence et de sévérité. L’incidence et la sévérité moyenne de la maladie ont respectivement des valeurs comprises entre 63,8 % à 100 %, et 19,9 % à 46,1 %.
Des espèces de champignons au nombre de 8 (huit) ont été inventoriés. Il s’agit de Lasiodiplodia spp (51 %), Pestalotia spp et Fusarium spp (13 %), Aspergillus niger (10 %), Colletotrichum gloeosporioides (6 %), Penicillium sp (5 %), Botrytis cinerea (2 %) et Curvularia lunata (1 %).
Ces résultats obtenus nous informent sur l’ampleur de la gommose d’anacardier, et sur les agents fongiques rencontrés dans les différents vergers des provinces étudiées au Burkina Faso. Une étude plus poussée sur la caractérisation moléculaire associée au test de pathogénicité permettrait de déterminer l’agent ou les agents fongique (s) associés pour un contrôle efficient de la maladie.
Remerciements
Cette œuvre scientifique a eu le soutien du Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles (CORAF) dans le cadre du projet TARsPro.
RÉFÉRENCES
Adetunji M.C., Ngoma L., Atanda O.O., Mwanza M. (2019). A polyphasic method for the identification of aflatoxigenic Aspergilla from cashew nuts. World Journal of Microbiology Biotechnology, 35: 15.
Alves E.S., Fonseca W.L., Silva L.G.C. da, Lima J.S., Cardoso J.E. (2020). Effect of climate and geographical conditions on the occurrence of cashew gummosis in the northeast of Brazil. Revista Ciência Agronômica, 51: e20186092.
Aung K., Jiang Y., He S.Y. (2018). The role of water in plant–microbe interactions. The Plant Journal, 93: 771‑780.
Banito A., Kpemoua E.K., Dayiwo R.K., Tedihou E., Sikirou R. (2022). Inventaire des maladies de l’anacardier (Anacardium occidentale L.) dans la préfecture de Tchamba au Togo. International Journal of Biological and Chemical Sciences, 15: 2514‑2525.
Brahima O., Sibirina S., Abdoulaye K.N., Nakpalo S., Daouda K. (2023). Assessment of agricultural practices impact on the development of arbuscular mycorrhizal fungi. Journal of Experimental Agriculture International, 45: 195‑204.
Brodsky H., Calderón R., Hamilton D.S., Li L., Miles A., Pavlick R., Gold K.M., Crandall S.G., Mahowald N. (2023). Assessing long-distance atmospheric transport of soilborne plant pathogens. Environmental Research Letters, 18: 104021.
Cardoso J.E., Francisco das Chagas Oliveira Freire, Filadelfo Tavares de Sá, Raimundo Nonato Martins Souza (1998). Disseminação e controle da resinose em troncos de cajueiro decepados para substituição de copa. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 17, 1‑4.
Cooke B.M. (2006). Disease assessment and yield loss. In B. M. Cooke, D. G. Jones, B. Kaye (Éds.), The Epidemiology of Plant Diseases (p. 43‑80). Springer Netherlands.
Coutinho I.B.L., Freire F.C.O., Lima C.S., Lima J.S., Gonçalves F.J.T., Machado A.R., Silva A.M.S., Cardoso J.E. (2017). Diversity of genus Lasiodiplodia associated with perennial tropical fruit plants in northeastern Brazil. Plant Pathology, 66: 90‑104.
Dianda O.Z., Kansie Y.J., Wonni I., Fernandez D. (2025). Phylogeny and pathogenicity of Lasiodiplodia species associated with gummosis and dieback of cashew (Anacardium occidentale L.) in Burkina Faso. Physiological and Molecular Plant Pathology, 138, 102698.
Dianda O.Z., Wonni I., Diana F., Traoré O., Zombré C.T., Borro F. (2020). In vitro efficacy of some plant aqueous extracts against two species of Lasiodiplodia associated to mango decline in Burkina Faso. International Journal of Biological and Chemical Sciences, 14: 2699‑2712.
El-Ganainy S.M., Ismail A.M., Iqbal Z., Elshewy E.S., Alhudaib K.A., Almaghasla M.I., Magistà D. (2022). Diversity among Lasiodiplodia species causing dieback, root rot and leaf spot on fruit trees in Egypt, and a description of Lasiodiplodia newvalleyensis sp. Nov. Journal of Fungi, 8: 1203.
Gnanesh B.N., Arunakumar G.S., Tejaswi A., Supriya M., Manojkumar H.B., Devi S.S. (2022). Characterization and pathogenicity of Lasiodiplodia theobromae causing black root rot and identification of novel sources of resistance in mulberry collections. The Plant Pathology Journal, 38: 272‑286.
Khatoon A., Mohapatra A., Bihari Satapathy K. (2017). Major diseases of cashew (Anacardium occidentale L.) Caused by fungi and their control in Odisha, India. International Journal of Biosciences, 11: 68‑74.
Kim S., Park H., Gruszewski H.A., Schmale D.G., Jung S. (2019). Vortex-induced dispersal of a plant pathogen by raindrop impact. Proceedings of the National Academy of Sciences, 116: 4917‑4922.
Masood A., Saeed S., Iqbal N., Malik M.T., Kazmi M.R. (2010). Methodology for the evaluation of symptoms severity of mango sudden death syndrome in Pakistan, Pak. J. Bot., 42: 1289‑1299.
Mathur S.B., Kongsdal O. (2003). Common Laboratory Seed Health Testing Methods for Detecting Fungi. International Seed Testing Association.
Monteiro F., Diniz I., Pena A.R., Baldé A., Catarino L., Batista D. (2020). First report of three Lasiodiplodia species (L. theobromae, L. pseudotheobromae, and L. caatinguensis) causing cashew gummosis in Guinea-Bissau (West Africa). Plant Disease, 104: 2522‑2522.
Moreira-Morrillo A., Cedeño-Moreira Á., Canchignia-Martínez F., Garcés-Fiallos F.R. (2021). Lasiodiplodia theobromae (Pat.) Griffon Maubl [(syn.) Botryodiplodia theobromae Pat] in the cocoa crop: Symptoms, biological cycle, and strategies management. Scientia Agropecuaria, 12: 653‑662.
Muntala A., Kwadwo Gyasi S., Mawuenyegan Norshie P., Larbi-Koranteng S., Kwekucher Ackah F., Afreh Ntiamoah D., Atef Mohamed M. (2021). Diseases and insect pests associated with cashew (Anacardium occidentale L.) orchards in Ghana. European Journal of Agriculture and Food Sciences, 3: 23‑32.
Musangi C.R., Juma B.S., Mukhebi D.W., Isoe E.M., Kibiti C.M., Mbinda W.M. (2024). Aspergillus population diversity and its role in aflatoxin contamination of cashew nuts from coastal Kenya. PloS One, 19: e0292519.
Nakpalo S., Sibirina S., Tchoa K., Kouabenan A., Mongomake K., Daouda K. (2017). Parasitical Fungi in Cashew (Anacardium occidentale L.) Orchard of Cote d'Ivoire. Plant Pathology Journal, 16: 82‑88.
Netto M.S.B., Lima W.G., Correia K.C., Silva C.F.B. da, Thon M., Martins R.B., Miller R.N.G., Michereff S.J., Câmara M.P.S. (2017). Analysis of phylogeny, distribution, and pathogenicity of Botryosphaeriaceae species associated with gummosis of Anacardium in Brazil, with a new species of Lasiodiplodia. Fungal Biology, 121: 437‑451.
Patsa R., Subhendu J., Arindam S., Subrata D., Poduval M. (2023). Identification and characterization of Fusarium falciforme, incitant of wilt disease in cashew seedlings and its management. Archives of Phytopathology and Plant Protection, 56: 1521‑1539.
Rahayu S., Pratama R., Imron M.A., Mahmud J., Nugroho W. (2021). The occurrence of gummosis on invasive Acacia decurrens after Mount Merapi eruption in Yogyakarta, Indonesia. Management of Biological Invasions, 12: 886‑900.
Rahman M.A. (2023). Identification of Lasiodiplodia theobromae [(Pat.) Griff. Maubl] as a causal pathogen of rain tree gummosis [Samanea saman (Jacq.) Merr] and its control management. Bangladesh Journal of Agriculture, 47: 78‑96.
RGPH (2009). Recensement général de la population et de l’habitation de 2006 (RGPH-2006) [Rapport de synthèse des rapports d’analyse RGPH-2006]. Ministère de L’Économie Burkina Faso et des Finances.
Salvatore M.M., Andolfi A., Nicoletti R. (2020). The Thin Line between Pathogenicity and Endophytism: The Case of Lasiodiplodia theobromae. Agriculture, 10: 488.
Savitha R.S., Garampalli R.H. (2022). First report of stem gummosis and leaf blight disease in Momordica charantia caused by Lasiodiplodia theobromae. Journal of Global Agriculture and Ecology, 14: 25‑33.
Thakre B., Soni U., Gour C.L. (2017). Use of suitable fungicides for the control of gummosis caused by (Phytophthora sp.) on Nagpur Mandarin in Satpura Plateau of Madhya Pradesh, India. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 6: 2395‑2400.
Turcotte C., Lanoue-Piché K., Marcoux J. (2017). Cerisiers nains rustiques au Québec – Chancre bactérien (Section 4; p. 1‑7). Coopérative de solidarité Cultur’Innov et ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ).
Wang W., Li J., Ye Z., Wang J., Qu L., Zhang T. (2021). Spatial factors and plant attributes influence soil fungal community distribution patterns in the lower reaches of the Heihe River Basin, Northwest China. Environmental Microbiology, 23: 2499‑2508.
Wonni I., Sérémé D., Ouedraogo I., Kassankagno A.I., Dao I., Ouédraogo L., Nacro S. (2017). Diseases of cashew nut plants (Anacardium occidentale L.) in Burkina Faso. Advances in Plants Agriculture Research, 6: 78-83.

Publié-e
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
© Revue Marocaine des Sciences Agronomiques et Vétérinaires 2025

Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.

Revue Marocaine des Sciences Agronomiques et Vétérinaires est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.
Fondé(e) sur une œuvre à www.agrimaroc.org.
Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à www.agrimaroc.org.