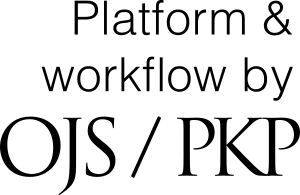Pratiques de gestion de la fertilité des sols des cuvettes oasiennes du sud-est du Niger
DOI :
https://doi.org/10.5281/zenodo.16609329Mots-clés :
Cuvettes oasiennes, fertilisation, rendement agricole, NigerRésumé
L’un des défis auxquels les exploitants des cuvettes du sud-est du Niger sont confrontés est sans doute le maintien de la fertilité des sols. Cette situation est d’autant plus préoccupante car ces cuvettes sont la source principale de production et de diversification agricole dans ces régions à potentialités agricoles très réduites. La présente étude cherche à analyser les pratiques de gestion de la fertilité des sols par les exploitants agricoles des cuvettes oasiennes du sud-est du Niger. Pour cela une enquête a été conduite auprès de 90 exploitants de ces cuvettes. Le logiciel R-studio a été utilisé pour l’analyse des données socioéconomiques et les pratiques de gestion de la fertilité des sols. Les résultats montrent que les pratiques de gestion de la fertilité du sol utilisées par les exploitants des cuvettes sont: l’utilisation du fumier, les engrais minéraux et les associations de cultures. Il n’y a pas des différences significatives entre les pratiques de gestion de la fertilité des sols et les rendements des principales cultures (maïs, oignon, chou et manioc). Selon les exploitants, les associations de cultures permettent de diminuer les coûts liés à l’achat de l’engrais, de bien gérer la superficie et de réduire le temps d’irrigation. Pour une agriculture durable, les exploitants des cuvettes oasiennes du sud-est du Niger doivent s’assurer de la bonne utilisation des fertilisants chimiques et leur combinaison avec les fertilisants organiques. Des études doivent être menées dans le domaine de l’association de cultures afin de trouver la combinaison la plus avantageuse aux exploitants des cuvettes.
Mots clés: Cuvettes oasiennes, fertilisation, rendement agricole, Niger
Téléchargements
INTRODUCTION
Le Niger, pays sahélo-saharien dispose d’un climat de type tropical sec où la saison des pluies ne dure que trois mois. Cependant, il dispose de nombreux atouts (ressources naturelles) pouvant servir dans l’amélioration des conditions de vie des populations. L’agriculture représente au Niger plus de 40 % du PIB national et constitue la principale source de revenus pour plus de 80 % de la population. Malheureusement, depuis plusieurs années, cette activité n’arrive pas à satisfaire les besoins alimentaires de ses pratiquants. L’insécurité alimentaire à laquelle font face les populations est chronique (Habou et al., 2016).
Au Niger, les cuvettes oasiennes constituent des zones de production agricoles non négligeables en zone aride. Du fait de la baisse généralisée de la production agricole suite aux effets du changement climatique (Ozer et al., 2010), les populations vivant à proximité des cuvettes déploient l’essentiel de leur effort dans leur exploitation pour pallier au déficit lié à la baisse de la production. Elles maintiennent en place des populations rurales car elles sont la source principale de production et de diversification agricole dans ces régions à potentialités agricoles très réduites (Tychon et al., 2009). Sans ces cuvettes, les populations seraient obligées d’émigrer, ce qui constitue actuellement un problème majeur en Afrique de l’Ouest (Gemenne et al., 2017). Les cuvettes s’organisent en auréoles concentriques, en pente douce vers le centre avec invariablement, l’auréole externe constituée essentiellement de doumiers denses (Hyphaene thebaica) et la plage centrale nue plus ou moins natronnée, parfois occupée par une mare (Ambouta et al, 2005). Au milieu se trouve l’auréole à polyculture où se pratiquent l’agriculture pour les cuvettes à eau affleurant et les cuvettes à eau intermédiaire. Dans ces cuvettes, les populations cultivent du mil, niébé et maïs en saison de pluies. Quant à la tomate, le chou, le poivron et l’oignon ils sont cultivés en saison sèche. Pour toutes ces raisons, il est plus que nécessaire de comprendre les techniques de gestion de fertilité de sols utilisées dans les cuvettes en fonction des saisons et leur effet sur la production agricole.
Plusieurs recherches ont été menées notamment par Ambouta et al. (2005), Mahamadou Barké et al. (2015), Krou et al. (2016) et Assane et al. (2021) dans les domaines des sols, de la cartographie et de l’ensablement des cuvettes. Mais force est de constater que ces études ne prennent pas en compte les trois Départements en même temps (Gouré, Goudoumaria et Mainé) sur l’aspect de la gestion de fertilité des sols des cuvettes oasiennes. La fertilité du sol c’est sa capacité à fournir aux plantes cultivées les éléments nutritifs dont elles ont besoin pour se développer et donner des graines, des fruits, des tubercules ou des feuilles en quantités importantes. Dans la plupart des cas, les plantes cultivées se nourrissent dans la couche superficielle du sol donc la fertilisation du sol concerne essentiellement cette couche, là où leurs racines trouvent et puisent leur nourriture.
Cette recherche a pour objectif d’analyser les pratiques de gestion de la fertilité de sols par les exploitants agricoles des cuvettes oasiennes du Sud-Est du Niger. Elle va permettre aux producteurs de cuvettes oasiennes de disposer d'informations nécessaires sur leurs pratiques de gestion de la fertilité des sols et de formuler des propositions d’amélioration.
MATÉRIEL ET MÉTHODES
Zone d’étude
L’étude a été réalisée dans les départements de Gouré, Goudoumaria et Mainé Soroa, au Sud Est du Niger. Les départements présentent un climat de type tropical sec avec une alternance de saison sèche longue de 8 à 9 mois et une courte saison des pluies de 3 à 4 mois. Les températures sont élevées de mars à mai et relativement basses de décembre à février (Ozer et al., 2005; Rabiou et al., 2020), Le sol est dominé par une mosaïque des dunes vives au Nord et des dunes fixées au sud, la végétation est de type steppique ouverte dominée par les herbacées (Rabiou et al., 2020). C’est une zone de cuvettes par excellence. Les cuvettes sont des dépressions inter-dunaires de section très variée dont la forme générale se rapproche de celle d’un tronc de cône renversé et qui sont localement dénommées «N’gors» (Ambouta et al., 2005). En tenant compte de la profondeur de la nappe on distingue trois sortes de cuvettes:
• Les cuvettes à nappe dont la profondeur est inférieure à 1,5 mètre, appelées cuvettes à eau affleurante (CEA). Dans ce type de cuvettes, on rencontre généralement quatre auréoles concentriques, la quatrième ou plage centrale étant généralement occupée par une mare;
• Les cuvettes dont la profondeur de la nappe est comprise entre 1,5 et 4 mètres, appelées cuvettes à eau intermédiaire (CEI). Ce genre de cuvettes compte trois auréoles concentriques, la troisième ou plage centrale étant nue;
• Les cuvettes à nappe dont la profondeur est supérieure à 4 mètres, appelées cuvettes à eau profonde (CEP).
En fonction du type d’exploitation, trois groupes de cuvettes peuvent être dégagés dans chaque grand type de cuvette: les cuvettes agricoles; les cuvettes agro-pastorales et les cuvettes pastorales (Ambouta et al., 2005). Bien que non toujours vérifiée, il existe tout de même une bonne relation entre la profondeur de la nappe dans les cuvettes et leur mode d’exploitation (Ambouta et al., 2005). Les cuvettes à eau affleurante et intermédiaire sont essentiellement agricoles avec un développement important de l’arboriculture et du maraîchage alors que les cuvettes à eau profonde sont presque exclusivement pastorales avec localement des cultures pluviales et quelques petits jardins.
Le choix des sites a été fait sur la base du zonage agro-écologique, l’accessibilité, la sécurité et le type des cuvettes. Neuf (9) cuvettes à vocation agropastorale ont été identifiées dont trois (3) à eau affleurantes (Adébour, Tchaballam et Bassori) et six à eau intermédiaire (Tissouwa, Balla, Gotanga, Toumourwa, Goudoumaria Nord et Kiria Mandaram).
Échantillonnage
Cette étude a été conduite sur la base des enquêtes au niveau des exploitants des cuvettes en juin 2024. Les enquêtes ont été menées à l’aide de trois outils de collecte: la fiche d’entretien individuel, le guide de focus groupe et le guide d’entretien en Assemblée Générale. Une visite préliminaire de ces cuvettes a permis de déterminer le nombre d’exploitants qui s’élève à 117. En somme, 9 focus-groupes femmes, 9 focus hommes, 9 entretiens en Assemblée Générale ont été tenus dans 9 villages à cuvettes et 90 exploitants enquêtés (en raison de 10 exploitants par village à cuvette). Cet échantillon d’exploitants a été calculé avec l’utilisation de la méthode d’échantillonnage exhaustif de l’équation de ci-dessous (Giezendanner, 2012):
n étant la taille de l’échantillon, N l’effectif des exploitants (N=117), I la fourchette d’incertitude (I=2e), e la marge d’erreur (comprise entre 0 et 10%; e=5%), t le coefficient de marge déduit du degré de confiance (1-α) que l’on souhaite (α le niveau de signification statistique = 5%, soit un degré de 95% et t associé = 1,96).
Le questionnaire a porté sur l’identité des producteurs et leurs caractéristiques socioculturelles, la tenure foncière, les techniques culturales, les spéculations cultivées, opérations d’entretien des champs, le mode de gestion de la fertilité des sols, les méthodes de lutte contre les ennemies de cultures, le rendement par spéculation et la commercialisation des produits.
Analyse des données
Le logiciel R-studio a été utilisé pour l’analyse des données socio-économiques et les pratiques de gestion de la fertilité des sols. Pour ces dernières, les analyses réalisées visent à montrer s’il existe des différences significatives par le biais d’une Anova (Analysis Of Variance) entre les quatre modalités, à savoir l’association des cultures, la fumure organique, les engrais minéraux et la modalité rendements des cultures.
RÉSULTATS
Données socio-économiques
Les exploitants des neuf (9) cuvettes sont des agriculteurs (46), éleveurs (12), des agro-éleveurs (30), et des commerçants (2) (Figure 1). Leur nombre varie en fonction de cuvettes et de sexe. Les hommes dominent dans toutes les activités (57/90).
Les cultures pratiquées
Les exploitants des cuvettes pratiquent plusieurs cultures en fonction de saisons (Tableau 1).
Les pratiques de gestion de la fertilité des sols dans les cuvettes
Les producteurs des cuvettes font recours à trois (3) pratiques pour fertiliser leurs champs. Il s’agit de l’utilisation des engrais minéraux, du fumier et des associations de cultures. Des engrais minéraux sont appliqués dans les parcelles ayant reçu leur premier sarclage. Le choix d’engrais selon les cultures est fait sur la base de la capacité financière, d’informations reçues des autres producteurs, des services techniques communaux et des résultats des années passées. Les doses d’engrais minéraux apportées diffèrent d’une culture à une autre. Les tableaux 2,3 et 4 donnent les doses apportées par culture et par saison.
Les engrais organiques utilisés par les exploitants des cuvettes sont produits avec plusieurs techniques. Le fumier utilisé par les exploitants des cuvettes, non composté, est constitué d’un mélange de divers produits (paille ou résidus de céréales, déjections d’animaux, fanes de niébé, déchets de ménagers, cendre de cuisine…). Il est souvent stocké en tas devant les concessions à l’air libre et transporté à l’aide des charrettes dans les parcelles au mois de mai, dès que la quantité est jugée suffisante. La diversité des pratiques témoigne aussi de l’adaptation des exploitants à de nouvelles situations et aussi de l’inadéquation des solutions apportées par la recherche et la vulgarisation. Les entretiens font ressortir que les exploitants agricoles ont reçu l’information et ont des connaissances sur la production du fumier. Des fosses creusées à côté des concessions et dans certaines parcelles attestent qu’il y a eu, au moins un moment, la pratique soit de compostage soit de production de fumier mais qui a tourné court pour des raisons diverses. Les principales contraintes évoquées ont trait, à l’investissement financier (charrette, animaux).
L’association des cultures est pratiquée par les exploitants des cuvettes en tenant compte des exigences en fertilité des sols de la culture, de l’habitude dans le choix des plantes, du mode de préparation du sol et de l’objectif visé. Selon eux, elle permet de diminuer les coûts liés à l’achat de l’engrais, d’avoir un bon rendement, de bien gérer la superficie et de réduire le temps d’irrigation. Le niébé (Vigna unguiculata (L.) Walp) est associé au maïs (Zea mays), le piment (Capsicum) avec la laitue (Lactuca sativa), l’oignon (Allium cepa) avec la tomate (Solanum lycopersicum L.). Les planches de chou ou poivron sont entourées des pieds de Moringa oleifera ou manioc (Tableau 5).
Perception des producteurs de mode de gestion de la fertilité des sols sur les rendements
Tous les exploitants enquêtés utilisent divers types d’engrais pour rehausser leur production. Les cultures les plus importantes dans les cuvettes selon les exploitants sont le maïs, l’oignon, le manioc et le chou. L'analyse de variance montre qu’au niveau de la figure 3, le mode de gestion par la fumure organique n’a pas engendré de différences significatives entre les rendements du maïs et oignon; maïs et chou; maïs et manioc; oignon et chou; oignon et manioc avec, p-value respectivement de 0,21; 0,48; 0,063; 0,25 et 0,33.
Au niveau de la figure 4, le mode de gestion par l’association des cultures n’a pas engendré de différences significatives entre les rendements du maïs et oignon; maïs et chou; oignon et chou; oignon et manioc et chou, avec p-value respectivement de 0,86; 0,89; 1,00 et 0,25, mais présente une différence significative entre les rendements de maïs et du manioc.
Au niveau de la figure 5, le mode de gestion par les fertilisants minéraux n’a pas engendré de différence significative entre les rendements du maïs et oignon; maïs et chou; maïs et manioc; oignon et chou; oignon et manioc, avec p-value respectivement de 0,54; 0,25; 0,093; 0,89 et 0,76.
DISCUSSION
Au niveau des cuvettes oasiennes du Manga (Goudoumaria et Mainé Soroa) et de Mounio (Gouré), les femmes et les hommes pratiquent l’agriculture et l’élevage. Ce résultat est semblable à celui de (Krou et al. 2016) dans les cuvettes de Gouré, où les activités des ménages sont principalement l’agriculture pluviale et l’élevage intensif et extensif. Toutefois, les exploitants pratiquent généralement deux, voire trois activités. Pour la gestion des exploitations, elles sont majoritairement dirigées par les hommes. Assan et al., (2021) ont affirmé aussi que les exploitations dans des cuvettes sont dirigées à 96,7 % par les hommes.
Le choix de cultures
Les producteurs agricoles des cuvettes optent pour une diversité des cultures en fonction des saisons à cause de la demande des consommateurs. Cependant, selon Krou et al,. (2016), la rentabilité est plus attrayante pour les spéculations à cycle court, comme l’oignon (69%) et le chou (65%). Les principales spéculations des cuvettes sont plus destinées à la vente (74%) qu’à l’autoconsommation (26%) (Awa Krou et al,. 2016). D’autres raisons peuvent prévaloir lors de choix des cultures par les producteurs comme le confirme les travaux de Fanou et al. (2010) au Bénin. Il ressort de leur étude que la décision du choix des cultures est prise par le chef ménage et est déterminée par les objectifs du ménage et les résultats de la campagne antérieure.
Gestion de fertilité des sols
Les producteurs utilisent les associations de cultures, le fumier et les engrais minéraux dans leurs pratiques culturales. L’utilisation de l’engrais minéral impacte positivement la production. Beaucoup d’études viennent corroborer ce résultat en montrant que l’application de la microdose de l’Urée et NPK, permet d’augmenter les rendements des cultures céréalières telles que le mil et le sorgho (Aune et al. 2007; Hayashi et al., 2008; Sogodogo et al., 2016; Tabo et al., 2007). Les résultats des tests de démonstration de l’application de la microdose d’engrais par le Centre Sahélien ICRISAT au Niger, au Mali et au Burkina Faso ont montré que les rendements de sorgho et de mil étaient de 44 à 120 % supérieurs avec le microdosage d’engrais, comparativement à l’ancienne pratique de fertilisation recommandée par la recherche (Tabo et al., 2007). Les travaux de Tounkara et al. (2020) ont montré l’efficacité des engrais inorganiques sur le rendement du mil dans les exploitations familiales du centre du Sénégal. D’autre part, les producteurs agricoles des cuvettes utilisent la fumure organique pour fertiliser leurs sols. La matière organique améliore la fertilité du sol en agissant sur les propriétés physico-chimiques du sol. Ce résultat est similaire à ceux de Mounirou et al. (2020) qui indiquent que l’utilisation du guano contribue à améliorer la production de la laitue verte. Aussi les études de Biaou et al. (2017) ont montré que l’utilisation du compost enrichi avec les fientes de volailles a induit des niveaux de rendements de carottes significativement élevés aux doses de 30 à 40 à t/ha. Les perceptions des exploitants sur la performance de l’association de culture ont montré que les associations niébé et maïs; piment et laitue; oignon et tomate sont pratiquées par les exploitants dans l’optique de diminuer les coûts liés à l’achat de l’engrais, d’avoir un bon rendement, de bien gérer la superficie et de réduire le temps d’irrigation. Ces résultats sont en concordances avec ceux obtenus par Coulibaly et al. (2012). En effet, ces auteurs ont montré que les associations culturales maïs/légumineuses sont des pratiques novatrices pour les producteurs qui permettraient de mieux gérer l’espace cultivable (de plus en plus rare) et de contribuer à améliorer la fertilité du sol par la fixation symbiotique de l’azote de l’air par la légumineuse. Les exploitations des cuvettes utilisent des doses fertilisantes chimiques ne dépassant guère 100 kg/ha. Aussi, le fumier est apporté sans aucune mesure adéquate. Ces données sont non conforme avec les travaux Haoua et al. (2023) au Niger, où ils ont montré que l’apport de 300 kg/ha de NPK et 20 t/ha de compost a donné des résultats significativement élevés des bulbes et feuilles d’oignon.
CONCLUSION
L’étude a montré que dans les cuvettes oasiennes du sud-est du Niger, les pratiques de gestion de la fertilité des sols sont l’apport de la fumure organique, l’apport des engrais minéraux et l’association des cultures. Cette situation parait satisfaisante aux exploitants, mais ces pratiques se font sans respect des doses recommandées de chaque fertilisant. Les associations de cultures maïs et niébé; piment et laitue; oignon et tomate; chou et Moringa oleifera n’ont pas pour but de rehausser le rendement mais plutôt, de diminuer les coûts liés à l’achat de l’engrais, de bien gérer la superficie et de réduire le temps d’irrigation. Des travaux de recherche doivent être menés en vue de proposer des solutions de choix des fertilisants et leurs normes techniques d’utilisation et, aussi les types d’association de cultures les plus avantageux.
RÉFÉRENCES
Ambouta K.J.M., Zabeirou T., Guéro M., Amadou B. (2005). Typologie des cuvettes et bas-fonds et possibilité d’exploitation agricole et de valorisation. Étude sur l’inventaire et la caractérisation pédologique et hydraulique des cuvettes oasiennes dans le Département de Maïné-Soroa. Rapport d’étude, Faculté d’Agronomie, Université Abdou Moumouni, Niamey, Niger, 25p.
Aune J.B, Doumbia M., Berthe A. (2007). Microfertilisation du sorgho et du mil au Mali: faisabilité agronomique, économique et sociale. Perspectives agricoles, 36: 199-203.
Assane M.M., Tidjani A.D., Manzo O.L., Ambouta K.J.M., Bielders C., Mahamane A. (2021). Les cuvettes oasiennes du Manga, Sud-Est Niger: un patrimoine à forte productivité agricole menacé d’ensablement, protégé par la fixation des dunes. Afrique Science, 18: 102-107.
Biaou O.D.B., Saidou A., Bachabi F.X., Padonou G.E., Balogoun I. (2017). Effet de l’apport de différents types d’engrais organiques sur la fertilité du sol et la production de la carotte (Daucus carota L.) sur sol ferralitique au sud Bénin. International Journal of Biological and Chemical Sciences, 11: 2315-2326.
Bodart C., Ozer A., Derauw D. (2010). Suivi de l’activité des dunes au Niger au moyen de la cohérence interférométrique ERS ½. Bulletin de la Société Géographique de Liège, 54: 123-136.
Coulibaly K., Vall E., Autfray P., Sedogo M.P. (2012). Performance technico-économique des associations maïs/niébé et maïs/mucuna en situation réelle de culture au Burkina Faso: potentiels et contraintes. Tropicultura, 30: 147-154.
Giezendanner F.D. (2012). Taille d’un échantillon aléatoire et Marge d’erreur. Genève: Instruction publique, culture et sport Service Écoles-Médias, 22 p. http://icietla-ge.ch/voir/IMG/pdf/taille-d_un-echantillon-aleatoire-et-marge-d_erreur-cms-spip.pdf
Gemenne F., Blocher J.M.D., De Longueville F., Vigil Diaz Telenti S., Zickgraf C., Gharbaoui D., Ozer P. (2017). Changement climatique, catastrophes naturelles et déplacements de populations en Afrique de l’Ouest. Geo-Eco-Trop: Revue Internationale de Géologie, de Géographie et d’Écologie Tropicales, 41: 317-337.
Habou M.K.A., Rabiou H., Karim S., Maazou R., Matchi I. I., Mahamane A. (2020). Caractéristiques floristique et écologique des formations végétales de Gouré (Sud-est du Niger). Revue Marocaine des Sciences Agronomiques et Vétérinaires, 8: 186-195.
Habou Z.A., Boubacar M.K., Adam T. (2016). Les systèmes de productions agricoles du Niger face au changement climatique: défis et perspectives. International Journal of Biological and Chemical Sciences, 10: 1262-1272.
Haoua B., Hamsatou B., Adamou H., Bibata A., Toudou A. (2023). Effets des fertilisants minéraux (NPK) et organiques (compost) sur la productivité de l’oignon (Allium cepa L.) au Niger: Cas de la variété violet de Galmi. International Journal of Innovation and Applied Studies, 41: 549-557.
Hayashi K., Abdoulaye T., Gerard B., Bationo A. (2008). Evaluation of application timing in fertilizer micro-dosing technology on millet production in Niger, West Africa. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 80: 257-265.
Karimou Barké M., Tychon B., Ousseini I., Ozer A. (2015). Détection des cuvettes oasiennes du centre-est du Niger par classification d’une image texturale basée sur la variance. Photo Interpretation European Journal of Applied Remote Sensing, 51: 24-36.
Krou M.B.A., Yamba B., Andres L., Lebailly P. (2016). Les cuvettes oasiennes du Niger Oriental: entre pratiques foncières et cadre législatif, 13 p.
Mounirou M.M., Harouna K.A., Tidjani A.D., Maigari M.H. (2020). Le guano, fertilisant organique naturel alternatif au fumier, testé sur la production de la laitue verte (Lactuca sativa L.) dans l’oasis de Balla (département de Gouré), Zinder, Niger. International Journal of Biological and Chemical Sciences, 14: 1025-1037.
Pierre Ozer, Catherine Bodart, Bernard Tychon (2005). Analyse climatique de la région de Gouré, Niger oriental: récentes modifications et impacts environnementaux. Cybergeo: European Journal of Geography.
Sogodogo D., Coulibaly B., Coulibaly B.Y., Sacko, K. (2016). Impact du microdosage d’engrais minéraux sur le rendement du sorgho dans les champs d’adoption des femmes formées à l’école d’agriculture de Niako dans la zone du Soudan du Sud au Mali. Revue internationale de microbiologie et de sciences appliquées actuelles, 5: 698-704.
Tabo R., Bationo A., Gerard B., Ndjeunga J., Marchal D., Amadou B., Koala S. (2007). Amélioration de la productivité céréalière et des revenus des agriculteurs grâce à une application stratégique d’engrais en Afrique de l’Ouest. Dans Progrès dans la gestion intégrée de la fertilité des sols en Afrique subsaharienne: défis et opportunités. Springer Pays-Bas, pp. 201-208.
Tounkara A., Clermont-Dauphin C., Affholder F., Ndiaye S., Masse D., Cournac L. (2020). Inorganic fertilizer use efficiency of millet crop increased with organic fertilizer application in rainfed agriculture on smallholdings in central Senegal. Agriculture, Ecosystems and Environment, 294: 106878.
Tychon B., Ambouta K.J.M., Ozer A., Bielders C., Paul R., Ozer P. (2009). Perspectives-Quel avenir pour les cuvettes oasiennes dans le Niger oriental ? Geo-Eco-Trop: Revue Internationale de Géologie, de Géographie et d’Écologie Tropicales, 33: 3-6.

Publié-e
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
© Revue Marocaine des Sciences Agronomiques et Vétérinaires 2025

Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.

Revue Marocaine des Sciences Agronomiques et Vétérinaires est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.
Fondé(e) sur une œuvre à www.agrimaroc.org.
Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à www.agrimaroc.org.